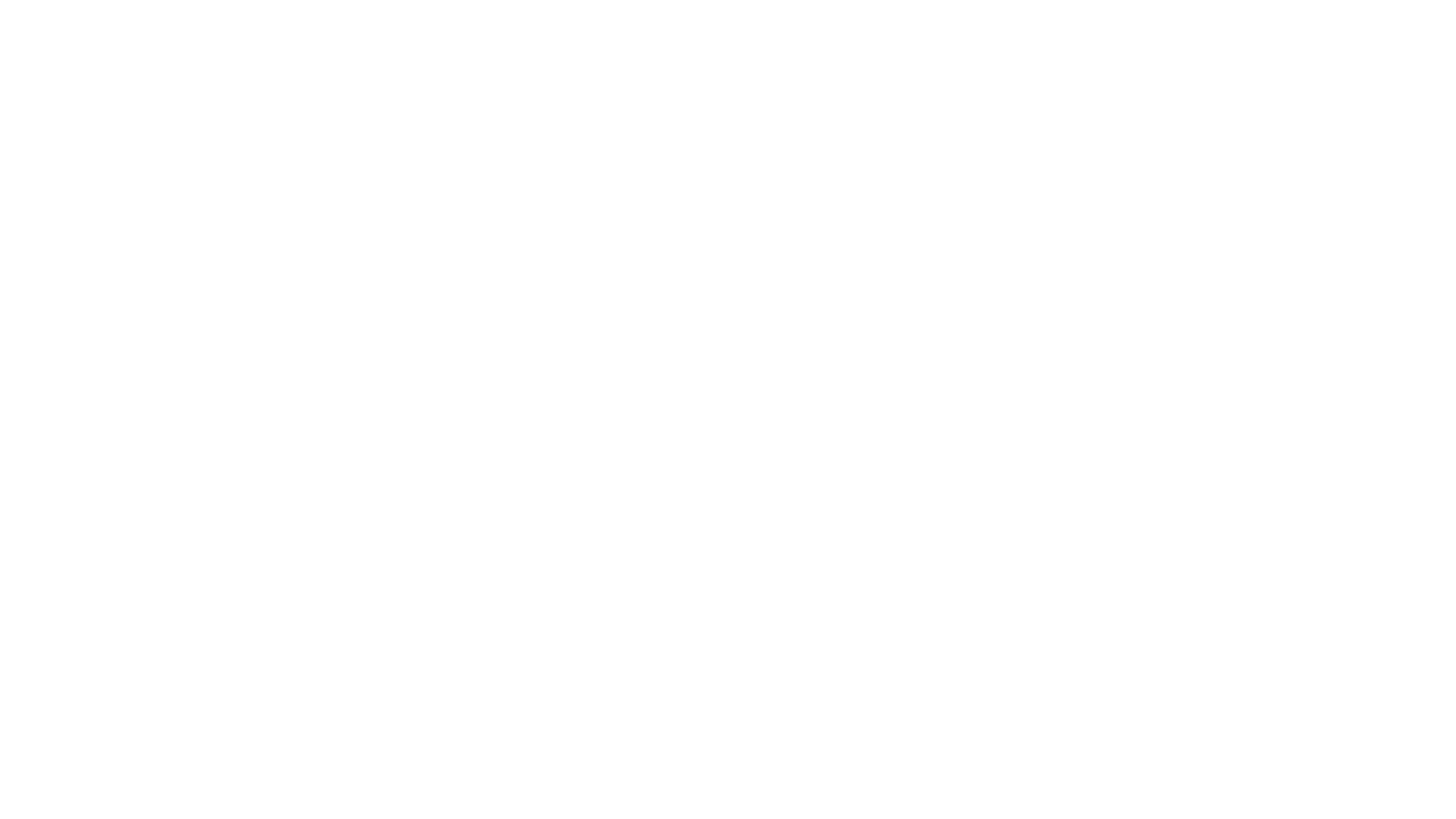Réunie le 29 octobre 2025, la Commission Extra Régionale de Citoyenneté (CERC) a dressé un constat inquiétant sur l’état du réseau d’eau potable, de l’assainissement et surtout de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) en Guadeloupe.
Les données rassemblées au cours de cette séance, nourries par les interventions de personnalités qualifiées telles que l’ancien haut responsable du SDIS Gilles Bazir et l’ancien maire de Pointe-à-Pitre Jacques Bangou, convergent vers un diagnostic clair : le risque incendie est devenu un point de vulnérabilité majeur sur le territoire, et la gouvernance du SMGEAG nécessite une restructuration profonde.
Un système d’eau et de défense incendie en dégradation
Le relevé de conclusions montre une tendance générale à la dégradation simultanée de trois missions essentielles :
– distribution d’eau potable
– assainissement
– défense extérieure contre l’incendie (hydrants, poteaux incendie, réservoirs)
La commission relève plusieurs critiques récurrentes concernant le fonctionnement du SMGEAG :
– manque d’impartialité dans la sélection des zones de travaux
– faible réactivité des équipes techniques, notamment en situation d’urgence
– opacité dans la gouvernance interne, pouvant entraîner une déresponsabilisation des élus
– absence d’entretien régulier des points d’eau incendie
Ce constat s’inscrit dans une réalité vécue par de nombreux Guadeloupéens : tours d’eau fréquents, détérioration du réseau et risque permanent d’insuffisance en eau, y compris pour les besoins de la sécurité civile.
Des responsabilités éclatées et un cadre juridique source de confusion
Le document met en lumière un problème majeur : la compétence liée à la défense incendie est partagée entre plusieurs niveaux institutionnels.
Selon le code général des collectivités :
– le maire est responsable de la défense extérieure contre l’incendie,
– les communes doivent créer et gérer les points d’eau,
– les communautés d’agglomération peuvent transférer cette compétence,
– le SMGEAG exerce la compétence en lieu et place des EPCI uniquement si celles-ci ont transféré la totalité de cette mission.
Or, seule la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre a procédé à ce transfert intégral.
Partout ailleurs, la compétence est morcelée, ce qui rend difficile la planification, l’entretien et le contrôle des équipements incendie.
Cette ambiguïté fragilise la sécurité des habitants et empêche d’élaborer une stratégie cohérente à l’échelle de la Guadeloupe.
Des points d’eau incendie souvent défaillants
Les obligations de contrôle des hydrants et des réservoirs incendie sont pourtant strictes :
– contrôle annuel du débit, de la pression et de la manœuvrabilité,
– établissement d’arrêtés municipaux listant les PEI opérationnels,
– transmission au préfet des résultats de contrôle.
Ces obligations ne sont pas systématiquement respectées.
En parallèle, les tours d’eau aggravent la situation : les points d’eau incendie se vident, certains hydrants deviennent inutilisables, et les interventions des pompiers se compliquent.
Le SDIS tente de compenser ces lacunes en s’équipant de camions-citernes à grande capacité et de pompes permettant d’utiliser l’eau de mer. Mais ces solutions ne peuvent pas remplacer un réseau fonctionnel, et l’utilisation d’eau saumâtre détériore rapidement le matériel.
Le cercle vicieux du tour d’eau
Jacques Bangou rappelle un mécanisme technique inquiétant :
chaque retour de pression après un tour d’eau provoque mécaniquement de nouvelles ruptures sur un réseau déjà fragilisé.
Ce phénomène, répété chaque semaine, multiplie les fuites et dégrade toujours davantage l’infrastructure.
Des risques majeurs pour la sécurité publique et la santé
La commission identifie plusieurs risques critiques :
– indisponibilité des hydrants et fragilité de la réponse incendie
– non-conformité de la station d’épuration de Pointe-à-Donne, qualifiée de désastre sanitaire
– augmentation de la demande en eau avec l’ouverture du nouveau CHU
– vulnérabilité de la station de Miquel, dont l’arrêt brutal affecterait immédiatement plus de 100 000 habitants
Ces alertes illustrent la dimension stratégique de la gestion de l’eau, bien au-delà du simple confort domestique.
La solution préconisée : une régie unique, professionnelle et indépendante
La CERC recommande la mise en place immédiate de la régie prévue par l’article 7 des statuts du SMGEAG.
Cette régie permettrait :
– de séparer clairement la décision politique de l’opérationnel
– de professionnaliser la gestion quotidienne
– de renforcer la transparence
– d’améliorer la réactivité sur le terrain
Un directeur général préfigurateur devrait être nommé rapidement pour définir les statuts, l’organisation, les effectifs et les modalités de fonctionnement. Il serait assisté d’un comité composé de représentants d’usagers, d’acteurs de la société civile et de spécialistes techniques.
La commission rejette l’idée de multiplier les régies, jugeant qu’une régie unique est plus à même de garantir l’équité territoriale et la cohérence des investissements.
Elle insiste en revanche sur la nécessité d’une organisation territorialisée ou d’une direction technique mobile pour assurer une intervention rapide dans tout l’archipel.
Une mesure complémentaire : développer les citernes d’eau de pluie
La CERC propose également que la CTAP adopte une stratégie visant à installer des citernes de récupération d’eau de pluie dans les écoles, les immeubles à grande hauteur et les zones à risque.
Ces réservoirs permettraient de réduire la pression sur l’eau potable et de constituer des réserves utilisables en cas d’incendie.
Ce type d’installations pourrait être partiellement financé par la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
Ce qu’il faut retenir de cette commission régionale
– Le risque incendie augmente, notamment en raison de la dégradation des points d’eau incendie.
– La gouvernance éclatée du SMGEAG ne permet pas une gestion efficace.
– La CERC préconise une régie unique pour professionnaliser et sécuriser la gestion de l’eau.
– La situation critique des stations de traitement rend urgente une réforme structurelle.
– Des solutions innovantes, comme les citernes d’eau de pluie, pourraient renforcer la résilience du territoire.